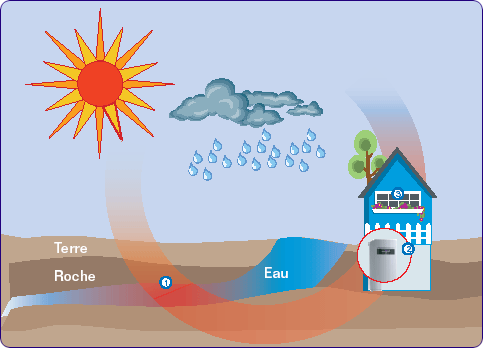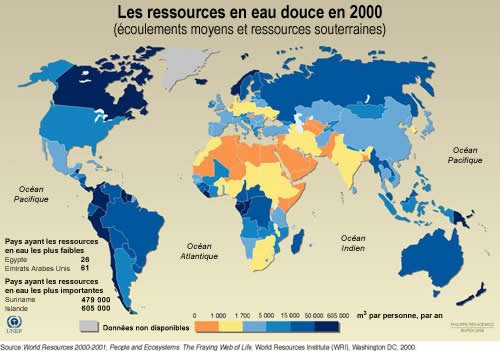GREFFES et TRANSPLANTATIONS.
Ce sujet va concerner l’histoire de la greffe , la façon de se procurer un coeur ou un rein ainsi que les précautions à prendre.
http://a3.img.v4.skyrock.net/a3f/avb-on-va-te-mater/pics/2609236246_1.gif
DEPUIS QUAND GREFFE-T-ON ?
Les premiers succès chez l’ Homme sont :
- 1959 pour le rein
- 1967 pour le coeur
http://www.france-adot.org/don-organe/don-organes.php
COMMENT PEUT-ON SE PROCURER UN COEUR/UN REIN POUR UNE GREFFE ?
À partir d’un donneur vivant
Une personne en bonne santé a la possibilité de donner un organe de son vivant. C’est le cas par exemple du rein, d’une partie du foie ou très rarement du poumon. On peut en effet vivre en bonne santé avec un seul rein, une partie du foie (car c’est un organe qui se régénère rapidement) ou une partie des poumons.
Ce don n’est possible que si le donneur est majeur et très proche génétiquement du receveur. La loi de bioéthique fixe la liste des personnes qui peuvent donner un organe de leur vivant. Cette liste est constituée par la famille proche (père, mère, conjoint, frères et sœurs, enfants, grands-parents, oncles, tantes, cousins germains, conjoint du père ou de la mère), ainsi que toute personne ayant vécu pendant au moins deux ans avec le receveur.
Les transplantations issues de donneur vivant les plus fréquentes concernent le rein, le risque pour le donneur étant extrêmement faible. Elles présentent en outre plusieurs avantages pour le receveur : elles fonctionnent en général mieux et plus longtemps que les greffes de rein à partir de donneur décédé. En outre, elles permettent de raccourcir ou de supprimer la période difficile d’attente en dialyse, ce qui comporte des avantages considérables sur les plans familiaux, personnels et professionnels. Pour le foie et le poumon, les risques pour le donneur sont beaucoup plus importants.
Il n’y pas d’age limite pour être donneur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Greffe_(m%C3%A9decine)#Pr.C3.A9l.C3.A8vement_d.27organe
http://a33.idata.over-blog.com/2/27/51/39/passports-cartes-temoins.gif
QUELLES PRECAUTIONS FAUT-IL PRENDRE POUR FAVORISER LA REUSSITE D’UNE GREFFE ?
Il faut :
- d’ une part, greffer un tissu ou un organe dont les caractéristiques bilogiques soient les plus proches de celle du receveur : c’est la compatibilité tissulaire
- d’ autre part, maîtriser les phénomènes inéluctables de rejet.
http://www.france-adot.org/don-organe/don-organes.php