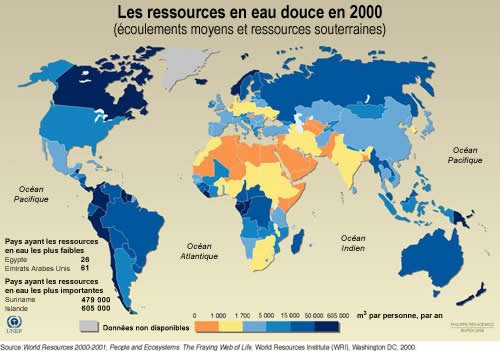La transfusion sanguine
Historique
Sous le nom de transfusion sanguine on englobe la collecte et l’utilisation du sang total (globules rouges, plaquettes qui servent à la coagulation du sang, plasma).
La transfusion sanguine est une idée ancienne. Au 17 ème siècle, plusieurs essais furent réalisés de l’animal à l’homme puis de l’homme à l’homme, qui se soldèrent par des échecs. La transfusion provoquait des réactions graves chez les transfusés, voire la mort, du fait de la méconnaissance des groupes sanguins à l’époque.
C’est en 1900 que Karl Landsteiner découvre l’existence des groupes sanguins, qu’il classe A, B, AB et O. Cette découverte fut suivie par celle du système Rhésus. En effet, si l’on transfuse à un individu un sang de groupe différent, il risque un accident d’incompatibilité. C’est Karl Landsteiner qui démontra que la transfusion était sans risque entre personnes du même groupe sanguin.
Après la guerre de 1914-1918, la transfusion devint plus sûre avec la mise au point de seringues spéciales qui permettent la transfusion veine à veine et la possibilité de conserver le sang en ajoutant du citrate de soude pour le rendre incoagulable.
De nos jours
En France le don du sang est anonyme et bénévole. Toute personne âgée de 18 à 65 ans peut donner son sang. Les donneurs doivent répondre à un questionnaire visant à éliminer les groupes à risques (hommes et femmes à partenaires multiples, toxicomanes) et à détecter les maladies infectieuses comme le SIDA.
Le sang est recueilli dans des poches plastiques contenant une solution anticoagulante. On recueille de 300 à 450 millilitres de sang. Le prélèvement se fait de préférence à jeun.
Il est ensuite analysé pour détecter les porteurs de virus et déterminer le groupe sanguin. Le sang est ensuite conservé à quatre degré dans un réfrigérateur ou dans une chambre froide.
La transfusion proprement dite
En chirurgie, la transfusion permet de compenser les pertes sanguines. Sans transfusion, la grande chirurgie, la prise en charge des accidentés de la route, ne seraient pas possibles.
Lors de la transfusion, le sang de la poche est directement transféré à la veine du receveur. Un dispositif de goutte à goutte distribue la bonne quantité de sang. Puis on surveille le receveur pour voir s’il n’y a aucune réaction anormale. La plupart du temps, seul un concentré de globules rouges est transfusé de manière à diminuer les volumes. Ces concentrés globulaires sont obtenus par centrifugation (séparation avec le plasma).
Le nombre de prélèvements de sang annuel en France est voisin de trois millions, contre quatre millions en 1985.
Les dangers de la transfusion
Entre 1980 et 1985, du sang contaminé par le virus du sida infecta de nombreux transfusés dont les malades hémophiles. Aujourd’hui le risque de contamination a considérablement réduit même s’il existe encore des risques de nature infectieuse : transmission de parasites tel le paludisme, ou de virus comme le SIDA.
Ces accidents transfusionnels ne doivent pas faire oublier que la transfusion sauve des milliers de vies, et cela grâce à la générosité des donneurs bénévoles.